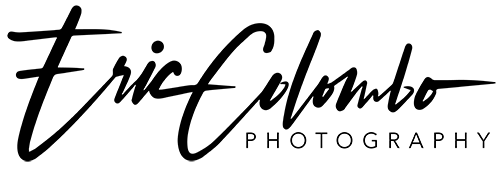Lady Cristal

Avenue de Montchoisi, Lausanne 1976
Elle était affairée à laver la vaisselle de son frugal repas du soir. Dehors, il faisait déjà nuit et, de ce fait, n'importe qui passant devant sa fenêtre bien éclairée pouvait la voir. D’autant plus facilement qu’elle habitait au rez-de-chaussée et qu’elle ne baissait jamais les stores de la cuisine. Si l’on prenait la peine de s’arrêter, et nul ne s’en privait, on pouvait constater que ce n’était pas une vraie blonde. Car chacun de ses déplacements ouvraient les pans de sa robe d’intérieur rouge et laissaient entrevoir un charmant triangle noir à l’endroit précis où ses longues jambes se rejoignent. Et elle n’avait pas toujours de robe d’intérieur. Heureusement que la fenêtre de sa cuisine donnait sur les places de parc situées derrière le petit locatif qu’elle habitait depuis bientôt une année dans ce quartier tranquille de Lausanne. Aussi, seuls quelques privilégiés qui venaient parquer leur voiture avaient droit à ce spectacle gratuit. Stella était pourtant consciente de s’exposer ainsi à la vue de tous, mais cela ne la gênait nullement. Au contraire, c’était toujours très légèrement vêtue, ou même nue, qu’elle se sentait le plus à l’aise; déformation professionnelle, sans doute, pour une strip-teaseuse.
C’était donc un soir comme celui-là dans le courant du mois d’octobre 1976; le téléphone sonna dans le salon. Tout en s’essuyant les mains à un linge de cuisine, elle alla décrocher et entendit aboyer dans le récepteur:
- Ouais, c’est moi ! Pour préciser que c’était lui.
- Tu es seule ?
- Ou.. Oui, bégaya-t-elle.
Son teint en avait pris un coup soudain.
- Bouge pas, j'arrive.
Clic. Déjà il avait raccroché. Elle savait qu’il serait là en moins d’une minute et qu’elle n’avait ni le temps de lui échapper, ni de demander de l’aide. Il avait sûrement téléphoné depuis la cabine de l’arrêt du bus, à moins de cinquante mètres. Sa main accusait un léger tremblement et elle tenait encore l’appareil quand la sonnette de la porte retentit brusquement. La peur la clouait sur place et il fallut un deuxième coup, encore plus impératif, pour qu’elle se décide à avancer. Autant lui ouvrir avant qu’il n’enfonce la porte. Celle-ci à peine entrouverte, il se précipita à l’intérieur du salon, non sans avoir jeté en passant un coup d’œil rapide dans les autres pièces, et se laissa tomber dans l’un des deux fauteuils de velours brun, lâchant ostensiblement les cendres de sa cigarette sur la moquette. Il avait son éternel costume gris-bleu ouvert sur une chemise bleu clair et, comme à l’accoutumée, ne portait pas de cravate.
Elle avait très peur de lui, mais encore plus des deux malfrats qui s'étaient appuyés discrètement contre le battant de la porte qu’ils avaient refermée silencieusement derrière eux. Elle avait toujours dissimulé sa crainte et, ignorant les deux orangs-outans, elle pénétra à son tour dans le salon en lançant crânement:
- Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Je t’ai déjà dit que tout est fini entre nous. Je ne veux plus te voir.
Il se leva et lui balança une gifle en guise de salutations.
- Salope ! Qu’est-ce que tu crois ? Tu m’appartiens et si tu veux reprendre ta liberté, tu connais le tarif. Je te l’ai déjà dit ; c’est dix mille balles.
Et il parlait en argent suisse, bien sûr.
⁃ Je te donne encore une semaine pour réfléchir ou pour trouver le blé, après quoi je te crève un oeil. Et n’essaie pas d’avertir les flics, car mes copains, que tu vois là, viendront t’arranger à ma place avec quelques suppléments de décoration faciale. Et comme la pratique est plus convaincante que la théorie, il envoya son poing droit sur la pommette gauche de la fille qui hurla en s'affalant sur le divan, la robe d'intérieur complètement ouverte. Les deux gars n'avaient pas bougé, à part un léger sourire et ils avaient imperceptiblement dégagé leur veston de côté, afin de laisser apparaître la crosse de leur flingue passé à la ceinture de leurs pantalons. Histoire de montrer qu’il y avait belle lurette qu’ils ne servaient plus la messe.
Ils étaient partis depuis quelque temps. Elle commença à se relever. Ses yeux étaient gonflés et une tache bleuâtre amorçait une auréole sous celui de gauche. Comme par enchantement une bouteille de Ballantine’s se trouva dans sa main droite et un verre dans l’autre. Elle avait besoin de réfléchir. Si ce n’était la douleur, il lui semblait avoir rêvé, tellement ce fut rapide. Pourtant, Michaël venait bel et bien de la mettre à l’amende. Et elle savait ce que cela voulait dire, car ce n’était pas la première fois qu’elle avait à faire à des maquereaux. Mais lui faisait partie du « gang des Lyonnais », c’était un autre pointure.
Etendue sur le lit, son whisky et ses Dunhills à portée de main, laissant couler les larmes sur ses joues, les années passées défilaient dans son crâne comme un film. Bien qu’elle n’aie pas trente ans, elle en avait déjà bavé et vu de toutes les couleurs. Mais elle avait envie de vivre. Vivre pleinement et librement, sinon à quoi auraient servies toutes ces épreuves, surtout la dernière, la plus grande, celle qui a marqué définitivement le tournant qu’elle avait choisi de suivre. Cette épreuve qui avait fait que, six mois auparavant dans une clinique voisine de son appartement, Monsieur Jean-Claude S. devienne LADY CRISTAL.
Tout à commencer à Lyon
Je suis né en 1947 et je ne fréquentais pas encore les écoles lyonnaises lorsque mon père nous abandonna. Il était sûrement retourné en Corse, mais ma mère ne chercha jamais à le savoir. Trop occupée qu’elle était, pour subvenir aux besoins de ma soeur et de moi-même, à faire des ménages à longueur de journée. Bien que nous ne vivions pas dans le luxe, nous n’avions pas eu une enfance malheureuse. Tous les matins, ma mère déposait ma soeur, qui était trois ans plus jeune que moi, chez une voisine et moi à la maternelle. Nous étions à nouveau réunis le soir pour consommer le repas que notre mère préparait, sitôt arrivée à la maison. Quand je fus plus grand, c’est moi qui emmenait ma soeur à l’école avant de m’y rendre moi-même.
Contrairement à mes camarades de classe qui allaient jouer dans les terrains vagues à la sortie de l'école, je préférais rentrer tout de suite à la maison afin de m’amuser avec ma petite soeur. Je m’installais devant le miroir, étalais du rouge sur mes lèvres, me parais de quelques colliers et boucles d'oreilles. Une jupe, un peu trop grande, achevait de me donner une image féminine que je contemplais en prenant un peu de recul et en faisant quelques pirouettes. Ma soeur devenait complice de mes jeux en m’appelant maman. Quelques fois, il est arrivé à ma mère de me surprendre dans cette tenue alors qu’elle rentrait un peu plus tôt que d’habitude. Elle me sermonnait gentiment, plus pour l'emploi de son bâton de rouge que pour le fait que dans ce jeu du papa et de la maman je ne prenais jamais le rôle du père. Il faut dire que je n’en avais point en modèle.
Au début des années 60, à l’âge de la puberté, le jeu bien innocent me fit connaître de nouvelles et étranges sensations. A la vue de mon image, de mon double au féminin devrais-je dire, il me venait de légers vertiges et une douce euphorie imprégnait tout mon corps lorsque je gainais mes longues jambes de bas nylon que j'avais subtilisés dans les affaires de ma mère. Les traits de mon visage étaient plutôt doux pour un garçon, aussi suffisait-il d'un peu de maquillage pour qu’il se féminisât. Mes cheveux, mi-longs, étaient coiffés de telle sorte que pour une fille, l’on aurait qualifié cette coiffure à la garçonne. Je partageais de moins en moins ces moments avec ma soeur qui était trop jeune pour comprendre que les règles du jeu avaient changé. Tout comme mes camarades de classe je cherchais, dans les journaux et les revues, des illustrations de femmes en déshabillé ou en soutien-gorge et porte-jarretelles. Mais si eux faisaient le brouillon de leurs amours avec ces photos servant de support à des rêves on ne peut plus érotiques, pour moi seule l’idée de ressembler à ces modèles me procurait une excitation. Dans ces moments là, je n’avais qu’une envie, celle de me précipiter dans la chambre de ma mère afin d'y puiser les instruments de ma transformation. Je prenais un immense plaisir à me travestir, mes mains caressant ce corps d'une autre et une intense jouissance me pénétrait. Je n’avais pas nécessairement besoin de me masturber à proprement parler pour jouir, rien que d’imaginer que les mains, qui allaient et venaient sur moi, appartenaient à des hommes me faisait venir la chair de poule. Puis, à chaque fois que je redescendais sur terre, le corps encore tout frissonnant, j’étais envahi d’un sentiment de culpabilité. J’avais conscience que mon attitude n’était pas normale, j’étais différent des autres et je n’osais avouer mes penchants à personne, ni même à ma soeur ou à ma mère. Je me sentais très seul. Cette différence je la vivais au quotidien. En classe, mes camarades flirtaient et se moquaient de moi parce que cela ne m’intéressait pas. Les filles se faisaient provocantes, voulaient que je les embrasse, mais je me défilais. Je refusais également les bagarres que les durs de l’école cherchaient. Ce qui me valait le surnom de gonzesse. Je n’avais pas ma place parmi eux et, ni tenant plus, un jour de printemps de mes quinze ans, je décidai de fuir. Demain, je n’irai pas à l’école!
Paris m'attirait. J'avais lu dans la presse tellement d’histoires sur les moeurs des gens de la capitale que je ne pouvais qu’y être plus à l'aise. Je décidai de voyager en stop, car je n’avais pu réunir que quelques sous de mes maigres économies. Je ne pouvais donner le but exact de mon voyage à la première personne qui me prendrait en voiture à la sortie de Lyon, cela aurait pu paraître louche. Vêtu d'un ensemble jean et d'un T-shirt, un sac de sport contenant quelques effets de rechange, il était environ huit heures et demi lorsque je m’installai sur le bord de la route pour lever le pouce.
Première fugue !
- Salut p’tit, me lance la conductrice d'une Ford Anglia blanche. Où vas-tu ?
- Je vais à Mâcon trouver ma tante qui est malade.
- Monte ! C’est sur ma route.
La voiture démarra et, alors que je me calai sur le siège, je me sentis soudain grandir. En ce lundi de mai 1962, je venais d’accomplir quelque chose d’important. Pour une fois j’avais oser agir en homme.
La femme conduisait avec beaucoup de sûreté et, peut-être était-ce la raison, parlait avec volubilité, sautant d'un sujet à l’autre, faisant les questions et les réponses.
- Qu’est-ce qu’il fait chaud déjà !.. Heureusement, il n’y a pas trop de circulation. Tu es bien installé ?.. Au fait, je peux te tutoyer ! J'ai un fils qui doit avoir ton âge... Il a l’intention d’avancer, celui-là ? Y en a, je t’assure, on se demande ce qu’ils font sur la route...
J’étais heureux d’être tombé sur ce genre de bavarde, ce qui me permettait de rêvasser, n’ayant pas à me concentrer sur le dialogue. De plus, cela m’évitait de devoir répondre à une question piège qui aurait mis en difficulté la suite de mon périple.
- J’espère que pour ta tante ce n’est pas trop grave? Ça me fait penser qu’il faudra que j’aille trouver une amie qui a accouché il y a deux jours. Tu as une préférence ou je te pose dans le centre ?
- Un peu après le centre, précisai-je en refaisant surface subitement.
Le trajet touchait à sa fin. Mâcon se dressait devant nous. Machinalement, je regardai ma montre : neuf heures quarante. J’indiquai un endroit, le plus proche de la sortie nord de la ville, pour qu’elle me dépose de manière à être déjà dans la bonne direction pour la suite du voyage. La dame me quitta en souhaitant la guérison de ma tante. Je fis mine de m’éloigner après l’avoir remerciée, puis, lorsque la Ford eut disparu, je retournai sur le bord de la route. Plusieurs véhicules passèrent sans s’arrêter, mais après une dizaine de minutes d’attente une Peugeot 303 verte vint se ranger sur le bas-côté à proximité de moi. Je m’approchais de l’auto, déjà la portière côté passager s’ouvrait. Cette fois-ci c’était un conducteur. Il avait la trentaine, des cheveux noirs coupés court, et portait un costume de ville gris clair avec une cravate assortie sur une banale chemise blanche. Je lui expliquai que je me rendais à Paris passer quelques jours chez un cousin, cependant mes finances ne me permettaient pas de prendre le train.
- Je connais ça ! J’ai aussi été jeune, me dit-il avec un large sourire souligné d'une fine moustache. Allez, monte ! Tu me tiendras compagnie.
Je jetai mon sac sur le siège arrière et mes fesses sur celui de devant. Tout en enclenchant la première il me précisa :
- Je ne vais malheureusement pas à Paris, mais seulement jusqu’à Auxerre. Mais cela te rapprochera de ton but.
J’acquiesçai tout en goûtant au confort de la voiture, je me sentais aux anges. Le paysage défilait rapidement et le poste de radio du tableau de bord distillait une rengaine en sourdine. L’homme me parlait, mais je l’écoutais distraitement. Il me racontait qu’il était représentant pour une firme quelconque et qu’il allait à Auxerre voir des clients. Je contemplais la Saône sur ma droite et me laissais bercer par la musique. Vers onze heures et quart, nous arrivâmes à Chalon-sur-Saône. Il regarda sa montre et me dit:
- Ça va bien nous pouvons être à Saulieu autour des douze heures trente et je connais un relais-routier comme ça ! Il ponctua ses paroles en embrassant le bout de ses doigts pour montrer que l’on y mangeait bien.
- On va s’en mettre plein la panse. Tu verras, c’est un vrai régal, rajouta-t-il. Tu as sûrement faim ?
- Un peu. Un sandwich me fera l’affaire.
J’avais faim, mais je pensais à l’état de mes finances. Si je dépensais tout avant d’arriver à Paris, ce serait malin.
- Taratata ! Tu vas faire un vrai repas.
Puis, comme s’il avait lu mes pensées, il précisa :
- Et ne t’inquiète pas, c’est moi qui t’invite. Je ne pourrais pas manger en te laissant me regarder.
Avant que j’aie pu rajouter quelque chose, il me donna une claque sur l’épaule et éclata de rire. La tête que je faisais. Je balbutiai de vagues remerciements. Comment arriver à croire qu’un monsieur que je venais à peine de connaître soit si gentil avec moi. Lyon me semblait si loin déjà.
Il rangea sa voiture devant le relais-routier. Déjà, plusieurs camions et remorques étaient alignés sur l’aire de stationnement réservé pour ces mastodontes. Le bâtiment semblait minuscule au milieu de cette immense place qui permettait aux plus gros d’entre eux de pouvoir manoeuvrer. Près de l’entrée du restaurant, des lignes peintes sur le bitume délimitaient la zone réservée aux automobiles.
Nous entrâmes dans l’établissement. La salle à manger paraissait étonnement grande par rapport à ce qu’on pouvait imaginer au vu de l’extérieur. Trois rangées de tables permettaient de se restaurer. Celles se trouvant côté fenêtre étaient les plus prisées; toutefois nous eûmes la chance d’en trouver une de libre, il se dirigea vers celle-ci tout en jetant un regard circulaire aux chauffeurs qui tout comme nous venaient se rassasier. Je le suivais et m'installai en face de lui. Le serveur, promptement, arriva sur nous pour nous donner une carte à chacun. Je l’ouvris pour y jeter un coup d’oeil. Sur la deuxième page, un feuillet - qui devait être changé chaque jour - était collé et l’on pouvait y lire: « Rôti de porc - Gratin dauphinois, Haricots - Fromage ou glace ». Je levai les yeux sur mon vis-à-vis; celui-ci, sans même me consulter rendait sa carte au garçon tout en commandant :
- Deux menus du jour et un quart de beaujolais, s’il vous plaît.
Puis me regardant :
- Tu boira bien un verre de vin avec moi ?
Et sans me laisser le temps de répondre il rajouta :
- Tu es presque un homme, dis donc... Au fait quel âge as-tu ?
- Dix sept, mentis-je. J’espérai n’avoir pas trop rougi en disant cela. Il remplit nos verres et nous trinquâmes à cette excellente journée.
- Moi, c’est Robert ! Et toi ?
- Alain, répondis-je en portant mon verre à ma bouche.
- Alain... Tiens tiens ! J’aime beaucoup ce prénom. Le beaujolais te convient ?
Je hochais la tête, alors que le breuvage descendait dans mon cou. Je n'étais pas habitué à boire du vin, buvant habituellement du coca ou d’autres limonades qui sont par nature sucrées, je trouvais le rouge un peu âpre; mais je ne laissais pourtant rien paraître afin de ne pas éveiller les soupçons sur ma méconnaissance des boissons d’adultes. Le repas terminé, je me sentais un peu grisé. Je ne savais si c’était le vin qui me montait à la tête ou la liberté que je commençais enfin à goûter. Nous reprîmes la route et, au bout de quelques kilomètres, il me demanda :
- Si tu n’es pas trop pressé nous pouvons nous arrêter un moment. Je connais un endroit charmant où nous pourrons faire une petite sieste pour nous aider à digérer ce bon repas. Qu’en penses-tu ?
Je trouvai que c’était une bonne idée, d’autant plus qu’avec le manège qui tournait sous mon crâne...
Nous nous engageâmes sur un chemin forestier. Au bout de quelques centaines de mètres, il stoppa la voiture près d’une jolie clairière baignée par le soleil. Je m’extirpai de l’auto et j’étirai mes bras en soupirant. Robert descendit à son tour et alla ouvrir le coffre. Il en sortit une couverture qu'il lança dans ma direction.
- Va l’étendre là-bas, nous y serons tranquilles.
Je me dirigeai vers l’endroit qu’il m’avait indiqué pendant qu’il pliait son veston et le posait sur le siège arrière. Je m’étendis sur le dos, les yeux contemplant le bleu du ciel et le vert des feuillages qui faisaient un peu d'ombre sur mon visage. J’étais bien, mon esprit vadrouillait à cent mille lieues, sur une île déserte. Je ne m’aperçus pas tout de suite de sa présence à mes côté. Mais lorsque sa main se posa délicatement sur mon torse je tournai la tête vers lui. Robert était couché à ma droite, la tête appuyée sur son coude, il me fixait en souriant :
- Ça va ?
⁃ Oui.
Il se pencha sur moi et, délicatement, posa ses lèvres sur les miennes. Il me sembla que mon coeur venait subitement de s'arrêter, puis dans la seconde qui suivit, je le sentis cogner comme un bûcheron dans mon thorax. J’avais envie de hurler. Combien de fois, quand je me regardais dans la glace, vêtu d’un soutien-gorge, d’un slip et des bas de ma mère, n’avais-je rêvé qu’un homme me prendrait dans ses bras en m’embrassant. Et aujourd’hui cet homme était là. Il m’embrassait alors que je n’étais même pas habillé en femme. Sa main s’était glissée sous mon T-shirt et se promenait sur mon torse imberbe. Doucement sa langue chercha un passage entre mes lèvres, celles-ci s’entrouvrirent tout naturellement, sa langue fouilla dans ma bouche et je sentis une décharge dans mon corps. Je n’avais pas réalisé tout de suite que mon slip était trempé et que, pour la première fois - je le saurai plus tard - j’avais jouis.
Robert s’en était aperçu et relâchant son étreinte, tout en continuant de caresser ma poitrine, il me dit :
- Tu as aimé mes baisers ?
- Oui, soupirais-je.
- Regarde comme tu m’excites.
En disant cela, il se dégrafa et sortit de son pantalon son sexe qui me parut énorme. Un frisson parcourut mon corps, alors qu’il me prenait la main pour la diriger sur sa verge.
- Caresse-moi !
Je ne savais trop que faire. Je touchai son membre qui me semblait en bois tant qu’il était dur.
- Suce-le, m’ordonna-t-il, en me poussant la tête d'une main ferme.
Je me laissai guider avec une certaine appréhension mêlée de curiosité. J’obéissais comme un automate, je n’étais plus moi-même. J’avais happé cette chose qui me fascinait, tel un serpent envers sa proie, et, accompagné de soubresauts, il se vida en moi. Je fus tellement surpris de ce qui venait d’arriver que je recrachai immédiatement ce liquide chaud et gluant que je sentais au fond de ma gorge. Je devais avoir les yeux rouges tant j’avais de la peine à reprendre mon souffle. Je le regardais en cherchant à comprendre ce qui s’était passé. Il eut un sourire moqueur et me dit :
- Pourquoi n’as-tu pas tout avalé ? C’est une partie de moi-même que je t’ai donné. Tu ne dois jamais refuser un tel cadeau.
- Ex... Excusez-moi, bégayai-je. J’ai été surpris, je ne savais pas ce qui arrivais.
- Tu n’as pas trouvé que ça avait un bon goût ?
- Si... Mais ça fait un peu... Comment vous expliquer... C’est... la première fois.
- Alors écoute mon garçon, tu sauras à l’avenir que si tu veux faire plaisir à un homme il te faudra tout avaler.
J’avais compris la leçon. Il m’embrassa une dernière fois, puis après s’être rajusté, nous reprîmes la route.
Retour case "Départ"
Le lendemain, j’étais devant ma mère, qui pleurait en me voyant arriver en compagnie de deux policiers. À mon arrivée à Paris, errant dans les rues sans savoir où aller, mon comportement avait attiré l’attention d’un policier qui m’avait emmené dans un commissariat de quartier. Pressé de questions, je n’avais pas tardé à avouer ma fugue. Après une nuit de sommeil dans une minuscule cellule, j’avais été renvoyé à Lyon.
Ma mère me serrait dans ses bras tout en écoutant les explications des policiers, et moi, je pleurais avec elle. Quand ils furent partis, elle me demanda comment j’avais fait pour voyager.
— J’ai fait du stop. Il m’a fallu seulement trois voitures : une jusqu’à Mâcon, puis une autre jusqu’à Auxerre, et la dernière m’a déposé vers la porte d’Italie, à Paris.
Je passai sous silence l’épisode de la clairière avec l’homme qui m’avait fait découvrir la sexualité.
Je retournai à l’école, et la vie reprit son cours quotidien. Pourtant, quelque chose avait changé : le soir, dans mon lit, je ne pouvais m’empêcher de revoir les images de la clairière. Tel un film, je me repassais la scène. Et, à chaque fois, je me masturbais en pensant à Robert. Il m’arrivait aussi de le faire en me regardant dans un miroir. Je caressais mes jambes gainées de bas en nylon, imaginant que c’était un homme qui posait ses mains sur moi. Jamais je n’avais souhaité que ce soit une femme.
Je découvris, dans des livres et des revues spécialisées, que d’autres que moi avaient cette même attirance. Pourtant, je ne me suis jamais considéré comme homosexuel, car intérieurement, je me sentais femme. J’étais convaincu que les hommes qui me désiraient cherchaient la femme qui était en moi. J’appris également qu’à Paris, dans le Bois de Boulogne, des travestis gagnaient de l’argent tout en réalisant leur fantasme : être femme.
N’étant plus aussi novice que la première fois, je décidai de faire ma deuxième fugue.
Paris 2ème voyage !
J’avais aussi quelques adresses de bars fréquentés par des travestis qui, je l’espérais, pourraient m’aider. J’étais bien accueilli dans ce milieu, car ma naïveté provinciale et mon accent lyonnais les amusaient. L’un d’eux — ou plutôt l’une d’elles — Gina, dans sa nouvelle personnalité, avait, tout comme moi, fui sa ville natale et vivait ici depuis quatre ans. Elle me proposa de partager sa petite chambre et sa grande expérience. Elle me conseilla sur mon habillement et m’apprit à me maquiller.
Je pouvais enfin sortir dans la rue, aller dans les magasins ou dans les restaurants habillé en femme. Je n’avais plus à me cacher ni à être le seul témoin de mon transformisme : je pouvais montrer à tout le monde ma féminité. J’étais heureux. Non ! J’étais enfin… heureuse. Claude-Alain était mort, Stella était née.
Le soir, Gina m’emmenait au Bois avec elle. Pour vingt francs, je relevais encore plus haut ma minijupe, laissant apparaître mon porte-jarretelles, et je faisais des prestations aux clients. Pour cinquante, ils avaient droit à une fellation et, s’ils m’allongeaient un billet de cent, je leur offrais mon corps. En effet, depuis ma première fugue, j’avais eu quelques aventures avec des hommes qui m’avaient fait découvrir les délices de la sodomie.
Certains soirs, refusant l’abri aléatoire des buissons, de bons clients m’invitaient à l’hôtel, où nous buvions du champagne et passions les trois quarts de la nuit à jouir de nos corps. Je me faisais payer cette prestation cinq cents balles. Je pris très vite goût à ce métier, qui me faisait gagner beaucoup d’argent et que je transformais aussitôt en froufrous et autres toilettes sexy.
Cette belle vie ne dura, hélas, que six mois. Un soir, je fus prise dans une rafle de police, et l’on découvrit que je n’avais que seize ans.
Cette belle vie ne dura, hélas, que six mois. Un soir, je fus prise dans une rafle de police, et l’on découvrit que je n’avais que seize ans. A nouveau, je fus reconduite à Lyon. Cette fois, je racontai tout à ma mère. Elle comprit finalement mon problème et admit que je ne trouverais mon bonheur qu’en laissant épanouir ma féminité. Je devais cependant m’habiller en homme le jour, mais le soir venu, elle fermait les yeux sur mes escapades déguisée en fille.
En attendant de remonter à Paris
Sous le nom de Stela, je commençais à fréquenter le « Milord », connu pour ses spectacles de travestis, où j’opérais comme hôtesse pour gagner un peu d’argent. Je me liai d’amitié avec les artistes, et très vite, j’eus envie de pratiquer ce métier. La plupart avait débuté chez « Madame Arthur », et c’est là que je ferai mes premières armes. En attendant de pouvoir remonter à Paris, cette fois dans des conditions légales, je continuai mon travail au « Milord ». C’est là que je découvris, à dix-huit ans, l’homosexualité. Enfin… ce que je prenais pour de l’homosexualité.
Une femme venait régulièrement boire un verre ou deux, soit en début de soirée, soit juste avant la fermeture du bar. Elle s’appelait Rolande, et tout de suite nous nous liâmes d’amitié. Peut-être parce qu’elle se prostituait et que je lui avais avoué avoir fait de même à Paris. Certains soirs, pour que nous puissions discuter tranquillement, elle me payait une coupe de champagne que je sirotais du bout des lèvres afin de rester le plus longtemps possible avec elle.
Une nuit, alors que nous parlions devant un verre, elle me proposa de finir notre discussion chez elle. Je me sentais tellement bien en sa compagnie que je n’hésitai pas une seconde. J’avais envie de connaître son appartement, de voir son cadre de vie.
Rolande habitait un joli petit studio situé au dernier étage d’un immeuble de trois niveaux. La pièce principale était baignée d'une lumière indirecte, diffusée par une lampe sur pied qu’elle avait allumée en arrivant.
— Tu prends un whisky comme moi ?
Je hochai la tête, tout en jetant un regard circulaire à la disposition des meubles. Il y avait un lit dans un angle, une armoire-penderie que j’imaginais remplie de vêtements divers — dont certains que je lui connaissais — et un fauteuil séparé du lit par une table basse servant également de table de chevet. Je m’installai dans le fauteuil pendant qu’elle préparait les boissons. J’entendais les glaçons sortir du freezer et tinter dans les verres, la porte de la cuisine restant ouverte. Elle réapparut, tenant les deux verres dans une main et la bouteille dans l’autre. Nous trinquâmes sitôt les verres remplis, puis elle posa le sien et me dit :
— Tu permets que je me mette à l’aise ?
Sans attendre ma réponse, elle se dirigea vers la porte de ce que je supposais être la salle de bain. Mon regard se posa sur un poster fixé au mur, au-dessus du lit : « Les jeunes filles en fleurs » de David Hamilton. J’aimais beaucoup ce photographe, peut-être parce que ses modèles me ressemblaient : pas de hanches, peu de poitrine, des corps d’adolescentes pas encore achevés.
— Tu aimes ce genre de photos ?
Rolande revenait, vêtue d’un déshabillé vaporeux blanc, croisé sur le devant et retenu par une fine ceinture de soie, laissant deviner sa nudité.
— Oui, j’aime beaucoup !
Ma réponse, accompagnée d’un regard appuyé, ne laissait pas de doute sur le fait que je ne parlais déjà plus du poster. Elle eut un sourire et s’assit sur le lit, face à moi.
— Ouf ! Ça va mieux… Quand j’arrive chez moi, il faut que je me déshabille tout de suite, entre les élastiques du slip et le soutien-gorge qui m’empêchent de respirer...
En parlant, elle croisa les jambes, dévoilant ses cuisses à travers les pans écartés de son déshabillé. Je restais muet, fasciné par ce corps que je découvrais sous un autre jour : au « Milord », l’éclairage était trop discret pour en deviner la beauté. Mon regard glissa vers ses seins, que je devinais bien ronds sous le tissu léger. Elle ne s’en vexa pas, au contraire : elle riait doucement, comme amusée. Puis, voyant ce que j’observais, elle glissa la main dans l’ouverture et prit délicatement son sein gauche.
— Tu les trouves beaux ? dit-elle en les découvrant totalement.
— Magnifiques !
J’espérais qu’un jour j’aurais une poitrine comme la sienne.
— Tu peux les toucher !
Elle s’appuya sur les mains, penchée en arrière, comme offerte. Je me levai et m’assis près d’elle, caressant cette poitrine de femme que je touchais pour la première fois. Elle se laissait faire, toujours avec son petit sourire presque moqueur, puis elle se redressa soudain, mit sa main derrière ma nuque et posa ses lèvres sur les miennes. Je reculais instinctivement.
— Tu n’as jamais couché avec une femme ?
— Euh… Non.
— C’est bien meilleur qu’avec un homme. Je couche avec eux seulement pour leur fric, mais je prends mon pied avec des minettes de ton genre… Allez, décontracte-toi, tu verras, c’est super. Quand tu auras goûté aux délices de Sappho, tu ne voudras plus de mecs. De toute façon, tu ne peux juger que si tu connais les deux.
Tout en parlant, elle défaisait déjà la ceinture de son déshabillé, qu’elle laissa glisser au pied du lit. J’avais envie de la toucher, de l’embrasser, mais en même temps j’étais gêné. Je restais hypnotisé par son pubis sombre, légèrement rebondi.
— Viens, embrasse-moi partout !
Déjà, elle m’attirait contre elle. Je me laissai aller à téter un sein, puis l’autre. Elle se tortillait sur le lit, gémissait, et prit ma main qu’elle guida fermement vers son intimité. Je la pénétrai du bout d’une phalange, mais elle fit monter son bassin et mon doigt s’enfonça dans son vagin mouillé. Elle jouit presque aussitôt, puis porta ma main à sa bouche et lécha mes doigts un à un.
Je n’avais toujours rien dit. Je me laissais entièrement guider par elle. Pendant qu’elle reprenait son souffle, je m’étais allongé à ses côtés. Elle vint se blottir contre moi, couvrit mon visage de baisers, et murmura :
— Il y a longtemps que j’ai envie de toi. Presque chaque fois que je te voyais au « Milord », je me faisais jouir en rentrant chez moi. Je t’imaginais comme maintenant, allongée ici, me caressant et me laissant te caresser.
Sa main, glissant sous ma jupe, remonta le long de mes cuisses. Elle s’arrêta brusquement en touchant mon slip. Elle se redressa, releva ma jupe, et, stupéfaite, arracha ma culotte en hurlant :
— Mais tu es un homme !
Elle me regardait comme si j’étais un monstre. Ce n’était pas le fait que je sois un homme qui la choquait le plus — elle couchait bien avec eux, fût-ce pour l’argent — mais d’avoir joui sous les caresses d’une personne qu’elle croyait femme. Sa voix me bouleversa. Celle qui un instant plus tôt me disait m’aimer me parlait désormais comme si j’étais le dernier des chiens.
Puis elle se leva, nue, et alla se servir un autre whisky. Je pleurais en silence. Quand elle revint, son visage s’était adouci. Elle avait perçu ma détresse. Elle me déshabilla entièrement, et nous nous glissâmes sous les draps. La tête dans le creux de son épaule, une main sur son sein, une jambe entre les siennes, je lui racontai tout. Elle m’écouta sans m’interrompre.
Quand je me tus, elle m’embrassa sur le front, puis sur les lèvres.
— Je t’aime. Même avec ton corps d’homme, tu as la mentalité d’une femme. C’est pour ça que je peux t’aimer.
— Je crois que je t’aime aussi… Je suis tellement bien près de toi, je sens que tu me comprends.
Elle m’embrassa pour me faire taire, puis m’allongea sur le dos. Ses doigts effleuraient chaque parcelle de ma peau. Arrivée à mon sexe, elle le prit entre ses lèvres et fit ce qu’il fallait pour le faire durcir. Quand mon érection fut suffisante, elle s’assit sur mes cuisses, écarta sa vulve d’une main et me guida en elle de l’autre. Elle s’allongea sur moi, m’embrassa, et fit bouger son bassin lentement.
Une vague nous emporta en même temps, soudain, et nous laissa pantelants. Nous nous endormîmes l’un dans l’autre.
Cette expérience ne fit pas de moi un homme, mais… une lesbienne.
Je suis père !
Je continuai quelque temps ma relation avec Rolande. J’aimais la douceur de ces moments intimes que nous partagions après nos heures de travail, mais il me fallait, de temps à autre, sentir la virilité d’un homme. Me faire prendre avec force et rudesse, m’avilir pour me permettre de jouir d’une manière dont Rolande, jamais, ne serait capable.
Aussi, certains soirs où l’un de mes clients me plaisait vraiment, je faisais un petit signe de connivence à Rolande, qui venait boire son dernier verre au « Milord ». Elle savait que j’allais m’éclater dans son studio — dont j’avais la clé — et qu’elle ne devait pas rentrer trop vite. Mais quand elle me retrouvait, alors que j’étais encore toute pantelante sur le lit défait, elle me prodiguait de douces caresses qui m’aidaient à revenir sur terre. La plupart des hommes, après avoir assouvi leurs envies, étaient pressés de rentrer chez eux, honteux d’avoir cédé à leurs bas instincts, mais à la fois fiers de s’être adonnés à des actes que les bourgeois qualifient de « contraires à la nature ».
Quand c’était Rolande qui avait une copine d’un soir ou d’une nuit, je lui laissais le champ libre et j’allais dormir chez ma mère, où j’avais toujours ma chambre. Finalement, notre idylle, basée davantage sur les sentiments que sur le physique, nous permettait quelques escapades aventureuses — plutôt qu’amoureuses — sans que cela mette en péril notre union.
Cependant, certains de nos moments de tendresse en tête-à-tête nous donnaient envie d’aller jusqu’au bout. Bien que cela fût rare, je le reconnais, Rolande acceptait la pénétration, du fait que j’étais peu membré et que j’y allais avec douceur, comme une femme que je me sentais être. Et, tout comme on peut jouer au loto toute une vie sans jamais décrocher la timbale, il n’est pas nécessaire de faire souvent l’amour pour mettre une fille enceinte. Ce qui devait arriver, sans que ni l’un ni l’autre ne l’imaginions, arriva : Rolande m’annonça un jour qu’elle attendait un enfant et que, par la même occasion, j’allais devenir père.
J’étais partagé entre la joie d’avoir pu procréer — mes hormones mâles bombant fièrement le torse — et l’angoisse de devoir gérer, en tant que femme, une situation pareille. Il était exclu que nous nous mariions : notre union était vouée à l’échec. Et nous ne pouvions pas envisager l’avortement. Il fallait aller à Londres ou à l’étranger ; quant aux interventions clandestines en France… c’était courir trop de risques.
Une fois encore, la solution vint de ma mère, qui se chargea du petit Serge à sa naissance, en mars 66, Rolande s’étant empressée de disparaître sous un prétexte futile. Nous ne l’avons plus jamais revue. Quant à mon fils, il reçut toute l’affection que l’on doit à un enfant de la part de ma mère, qui s’en occupa comme s’il s’était agi du sien.
Madame Arthur
Cette fois, avec le consentement de ma mère, je décidai de repartir pour Paris afin de travailler et de pouvoir lui envoyer de l'argent. Avec tous les renseignements et les recommandations que j’avais glanés en travaillant au Milord, je me présentai au cabaret « Chez Madame Arthur » afin d’y apprendre le métier d’artiste de revue.
Je me fis beaucoup de copines parmi mes camarades de revue et je découvris qu’il existait trois sortes de travestis. Bien que nous utilisions plus ou moins les mêmes moyens, nos objectifs étaient très différents. Il y avait d’abord les véritables artistes qui, tous les soirs, après avoir embrassé femme et enfants, venaient au cabaret jouer un rôle de composition : c’étaient les moins nombreux, il est vrai.
La majorité, elle, se composait de pédés qui se travestissaient uniquement parce qu’ils appréciaient cette situation ambiguë et le jeu de séduction auprès des autres mâles, mais qui, en aucun cas, n’auraient voulu perdre leur attribut masculin ni avoir de la poitrine ; ils acceptaient tout au plus de s’épiler le torse.
Enfin venait une autre minorité — celle à laquelle j’appartenais — les « mal-dans-leur-peau », qui cherchaient à assumer leur féminité aussi bien sur scène que dans leur vie de tous les jours : les transsexuels. C’est évidemment avec ces derniers que je me liais le plus souvent d’amitié, et ce sont eux qui m’apprirent à aller encore plus loin dans mon transformisme.
Je commençai, à cette époque, à me faire des piqûres d’hormones féminines. Je me souviens que, les premières fois, cela se passait dans nos loges avant le spectacle. Je n’osais pas me piquer moi-même et je devais avoir recours à l’expérience des plus anciennes pour qu’elles me l’administrent. Puis, comprenant que je devais passer par là pour atteindre mon but, je finis par y arriver toute seule. Le résultat ne se fit pas attendre : en quelques mois, ma poitrine prit de jolies formes, comme celle d’une enfant de douze-treize ans. La barbe et la pilosité masculine de mon corps disparurent peu à peu, et mon sexe — qui, comme je l’ai déjà dit, n’était pas des plus costauds — s’atrophia encore davantage pour devenir vraiment insignifiant : il me suffisait d’un bout de scotch pour le fixer et le dissimuler entre mes jambes.
Arrivée à ce stade de transformation, je ne pouvais plus rester « Chez Madame Arthur », car cette revue présentait uniquement des spectacles de transformistes et non de transsexuels. J’avais le choix, comme d’autres avant moi, d’aller soit au « Carrousel de Paris », soit de m’inscrire dans une agence pour faire des spectacles en solo dans les night-clubs à travers toute l’Europe.
Comme cela faisait deux ans que je faisais de la revue, j’avais envie de changer et de découvrir d’autres villes que Paris. Je pris donc un impresario et commençai une nouvelle vie mouvementée : un mois ici, un autre là, je faisais mon tour de France dans des boîtes souvent minables pour un cachet de misère.
Enfin… cela me permettait de vivre et d’envoyer régulièrement de l’argent à ma mère. Et quand je me trouvais pas trop loin de Lyon, ou que je prenais quelques vacances, j’en profitais pour aller embrasser mon fils, qui grandissait et m’appelait maman.
Stripteaseuse pro
Au début des années soixante-dix, je décidai, sous le nom de Lady Cristal, de faire une tournée en Suisse. Mon impresario m’avait donné l’adresse d’une agence lausannoise et je signai un contrat pour neuf mois. La loi suisse ne permet pas à un artiste étranger de rester plus de neuf mois par an sur son territoire : il faut obligatoirement quitter le pays pendant au moins trois mois avant de pouvoir revenir. Je trouvai, plusieurs années plus tard, différentes ruses pour contourner cette loi.
J’aimais beaucoup travailler en Suisse, car, avec le change des deux monnaies, je pouvais aider encore davantage ma mère sans me priver. De plus, les filles étant mieux payées — entre vingt et quarante francs suisses par jour — que les travestis, j’avais convaincu mon impresario de ne pas dévoiler mon état civil réel. Je réussis, pendant quatre ans, à travailler dans presque tous les night-clubs du pays sans que l’on découvre le pot aux roses.
Avec les clients, je n’avais pas de problème : je me contentais de leur faire une fellation et de me laisser caresser les seins. Quand ils voulaient me toucher sous mes jupes, je prenais une voix désolée pour leur expliquer :
« Tu n’as pas de chance, mon chéri, j’ai justement mes règles qui viennent de commencer. »
À chaque fois, c’était la même réaction : ils retiraient très rapidement leur main.
Mais c’était avec les autres strip-teaseuses que je devais faire très attention, car il y a beaucoup de jalousie dans ce métier. Pourtant, un soir, alors que je me préparais dans les loges pour faire mon numéro, j’allai, comme tous les soirs, aux toilettes pour coller mon sexe et mettre mon string. J’avais oublié de fermer la porte à clé et une fille me surprit ainsi. Immédiatement, elle alla vers le directeur et lui dit perfidement :
— Je croyais que votre établissement présentait uniquement un spectacle de filles. Je ne savais pas que vous aviez aussi des travestis !
— De quoi ! Il n’y a jamais eu de travestis chez moi et il n’y en aura jamais.
— Et Lady Cristal ? lança-t-elle en s’éloignant.
Le directeur me convoqua, et je dus reconnaître mon état. Il téléphona aussitôt à mon agent qui, pour se défendre, lui jura qu’il n’était pas au courant et qu’il avait été berné. Mon contrat fut cassé à l’instant même et je dus prendre un autre impresario ; le mien, pour garder sa crédibilité, ne pouvait plus s’occuper de moi.
Je me plaisais de plus en plus en Suisse romande, d’autant que j’avais rencontré Charly, serveur dans un night-club de Lausanne. Nous avions le même horaire, ce qui nous permettait de profiter au maximum d’être ensemble. J’écartais donc autant que possible les contrats qui m’envoyaient dans la partie alémanique ou italienne du pays.
Je pris un appartement à Lausanne, tout près de la gare. Cela m’offrait un semblant de chez-moi, et c’était moins cher que les minables studios que l’on me proposait de mois en mois et de ville en ville. Ainsi, je pouvais non seulement travailler dans les cabarets lausannois, mais aussi aller, grâce aux trains, à Genève, Montreux ou Vevey et rentrer chez moi après le travail.
J’installai très rapidement Charly dans mon petit deux-pièces-cuisine et je lui offris une Toyota, un briquet Dupont et quelques autres petits cadeaux ; ne dit-on pas qu’ils entretiennent l’amitié ? Lui, partant de l’adage « Qui aime bien, châtie bien », me filait des gnons à tour de bras, mais savait me sodomiser comme personne… Bref, la belle vie.
Je voulais mettre de l’argent de côté pour subir l’ablation de mon sexe, mais Charly avait toujours besoin de quelque chose, et je ne savais pas refuser.
Je rencontre un photographe libertin
Un matin, à quatre heures, alors que je sortais du Métropole et me dirigeais vers mon logement de l’avenue de la Gare en passant sur le Grand-Pont, une Toyota jaune s’arrêta à ma hauteur.
— Bonjour ! me lança le conducteur. Voulez-vous que je vous dépose chez vous ?
— Non merci, je n’habite pas très loin, répliquai-je en continuant de marcher.
Il roulait au pas à mes côtés et insista :
— Montez quand même, j’ai à vous parler.
Je restai silencieuse, comme si je n’avais pas remarqué sa présence. Il accéléra et s’éloigna par l’avenue du Théâtre, tandis que j’empruntais la rue en pente du Petit-Chêne. Je pensais en être débarrassée, mais quelle ne fut pas ma surprise de retrouver sa voiture — et lui dedans — à vingt mètres de chez moi.
— Vous voyez, me dit-il, vous auriez pu vous économiser des pas.
— Vous ne pouvez pas me laisser tranquille ? Qu’est-ce que vous voulez ? Je vous avertis tout de suite que je ne suis pas seule, mon ami m’attend.
— Bof ! Il dort, votre ami. Je veux juste vous parler. Voilà : je suis photographe, spécialisé pour les artistes de cabarets.
— Ah ? Bon… Parquez-vous là.
Je lui désignai une place de parking. Il descendit de sa voiture et, en me tendant sa carte de visite, ajouta :
— Je m’appelle Eric, et vous ?
— Lady Cristal ! C'était mon nom de scène.
— Vous n’avez pas besoin de photos ? Vous êtes très jolie, je pourrais faire de belles photos, et pas trop chères.
Nous avions toujours besoin de photos : certaines pour l’entrée de l’établissement afin d’appâter le client, d’autres que notre impresario utilisait pour obtenir nos contrats. Les directeurs artistiques nous engageaient sur images.
— Vous me trouvez jolie ? Vous dites ça à toutes les filles !
— Non, pas du tout ! J’aime beaucoup votre poitrine.
— Vous avez déjà vu mes seins ? m’étonnai-je.
— Non, pas encore, mais je les imagine à travers votre pull… d’autant plus facilement que vous n’avez pas de soutien-gorge.
Je le dévisageais tout en discutant. Brun, frisé, un mètre quatre-vingt, moustache à la Brassens, beaucoup de charme : le genre dragueur. Il me baratinait sur ce parking à quatre heures et demie du matin, et je trouvais la situation cocasse. Le jour commençait à poindre. Eric avait fini par obtenir que je relève mon pull pour lui montrer mes seins, mais j’avais demandé en échange de voir son membre et, très décontracté, il s’était exécuté.
Je le revis quelques jours plus tard. J’avais passé l’après-midi chez une copine travaillant dans un autre night-club lausannois et je rentrais chez moi, en faisant du lèche-vitrine. Je reconnus Eric qui montait dans sa voiture — ou plutôt, je reconnus d’abord sa voiture. J’accélérai et me retrouvai à la hauteur de sa portière avant qu’il ne démarre. Me penchant à sa fenêtre ouverte, je l’interpellai :
— Salut le photographe, ça va ?
— Oh ! Lady Cristal ! Quelle bonne surprise. Je suis content de te voir. La forme ?
— Oui, extra. Tu peux me ramener à mon domicile ?
— Bien sûr, monte !
En disant cela, il se pencha par-dessus le siège de droite pour débloquer la portière. En m’installant, je me remémorai notre rencontre du matin.
J’avais rangé sa carte au fond de mon sac à main et, avant de nous séparer, je lui avais dit n’avoir pas besoin de photos pour l’instant, ayant fait une série la semaine précédente. Il m'avait demandé :
— À Neuchâtel, je suppose ?
Avant que j’aie pu répondre — étonnée qu’il sache cela — il ajouta :
— Je ne sais pas pourquoi vous allez toutes là-bas, chez ce vieux. Il ne fait que du noir et blanc et son décor, des colonnes pseudo-gréco-romaines, on les retrouve sur toutes les photos… C’est d’un goût !..
Je devais admettre qu’il avait raison, mais quand on a besoin de photos, on se renseigne auprès d’une collègue, qui tient l’adresse d’une autre, et ainsi de suite. C’est ainsi que, pendant des périodes entières, les devantures des night-clubs de Suisse romande affichaient les mêmes poses, les mêmes décors, la même morosité. Je lui promis de penser à lui la prochaine fois, et de transmettre son adresse si besoin.
— Tu rêves ? me demanda-t-il.
Je réalisai que nous étions engagés dans la circulation dense de fin de journée, avançant de dix mètres au feu vert avant de patienter au rouge.
— Non… non, répondis-je mollement. Je pensais à autre chose…
Ah ! Au fait, j’ai collé ta carte de visite contre le miroir de la loge, pour que les filles puissent la voir. Tu vois, je t’avais dit que je te ferais de la pub…
— Chouette ! C’est sympa ! Tu es une chic fille.
Il me caressa la joue gauche, comme si nous étions de vieux copains. Curieuse, je profitai du trajet pour le questionner sur sa vie privée. Il m’apprit qu’il vivait avec une femme, Juliette, qui avait deux filles de cinq et huit ans, d’un premier mariage. Ils n’étaient pas mariés et se vantaient d’un modernisme où nul contrat n’est nécessaire pour s’aimer : amour veut dire partage — joies, peines… et plaisirs. D’autant plus facilement que Juliette était bisexuelle, et qu’ils partageaient parfois des amies qu’ils draguaient ensemble ou séparément, selon affinités.
— S’agit-il toujours d’une femme, ou vos soirées peuvent-elles être agrémentées d’un homme ?
— Non, uniquement des femmes.
Il ajouta, avec un petit sourire railleur :
— Je ne suis pas pédé.
— Et avec un travesti, vous avez déjà essayé ? lui demandai-je, presque timidement.
Il réfléchit, puis répondit :
— Non, nous ne connaissons pas de travesti.
Nous laissions quelques secondes entre chaque question et chaque réponse. Lui devait conduire ; moi, je regardais distraitement les passants sur les trottoirs, préparant ce que j’allais lui révéler.
— Et bien maintenant tu en connaît un !
— Mais non, répliqua-t-il, je te dis que je n'en connais pas.
— Mais moi je suis un travesti !
Eric ne répondit pas tout de suite. Il avait du mal à réaliser : lui, le dragueur macho, avait soulevé… un mec.
— J’aimerais bien connaître Juliette… Tu crois que ce serait possible de faire l’amour à trois ?
— Je ne sais pas ? Peut être, je dois en parler à Juliette.
Arrivé devant chez moi, il stoppa la voiture, continua un moment à regarder droit devant lui, puis demanda enfin :
— C’est vrai, ce que tu me racontes ?
— Bien sûr ! Pourquoi inventerais-je cela ?
Il éclata de rire.
— Quand je vais raconter ça à Juliette, elle va se moquer de moi !
Pour lui prouver mon état, je l’invitai à monter chez moi : j’étais seule — ayant enfin rompu avec Charly — et j’avais envie de faire l’amour.
— Tu ne veux pas essayer de me prendre par derrière ? On met un peu de vaseline et tu verras, ça ira tout seul.
Il secoua la tête en prétextant un rendez-vous. Je savais qu’il avait peur : il refusait toute relation qu’il aurait pu juger homosexuelle. Mais il me promit de me téléphoner pour aller boire un verre à trois et me présenter à Juliette.
Juliette et Eric de vrais amis
Depuis qu’Eric m’a présenté Juliette, je sais que j’ai deux véritables amis. Nous nous voyons constamment : un soir chez eux, un autre chez moi. Nous n’avons toujours pas fait l’amour ensemble, Eric restant très réservé sur ce sujet. À peine accepte-t-il, lorsque nous nous faisons la bise, de m’en déposer une troisième sur les lèvres après la joue gauche et la droite. Parfois, il se laisse aller à me caresser les seins, mais jamais sa main ne descend sous le niveau de la ceinture.
Je m’entends très bien avec eux ; ils connaissent toute ma vie et m’aident à ne pas commettre trop d’erreurs. Comme le jour où j’ai failli recommencer avec Charly : ils ont su me faire ouvrir les yeux sur les raisons très pécuniaires qui le poussaient à me refaire la cour.
Un soir, alors que nous mangions chez eux, je leur racontai ce qui m’était arrivé la veille :
— Je buvais un verre au bar du Lausanne-Palace, la Cravache. Tout en discutant avec ma voisine — que je connaissais vaguement pour l’avoir déjà rencontrée là — un client, que je n’avais pas remarqué tout de suite, s’installa sur le tabouret à ma gauche. Quand le barman lui servit sa boisson, je me retournai pour voir qui c’était. Un homme d’une cinquantaine d’années, un peu dégarni, mais vêtu avec un raffinement incroyable. Il me regarda, esquissa un sourire, leva son verre et fit mine de trinquer. Je fis de même. Puis, d’un signe discret de l’index en direction du barman, il commanda une boisson pour ma copine et pour moi.
Une fois servis, nous le remerciâmes, et il se mit à parler : d’abord de la pluie et du beau temps, puis — en se penchant vers moi pour parler à voix très basse — il me demanda :
— Vous faites l’amour avec votre amie ?
— Bien sûr, mentis-je du tac au tac. Ça vous intéresse ?
— J’ai une chambre au Palace. Je vous offre cinq cents francs à chacune si vous montez avec moi et que vous me laissez assister à vos ébats.
J’expliquai discrètement la situation à ma copine, avec qui, en vérité, je n’avais jamais couché. Elle s’offusqua et refusa net, même pour « faire semblant », comme je lui proposai devant ce vieux dégoûtant, selon ses mots.
— Mon amie n’est pas bien disposée aujourd’hui, mais je peux venir seule et nous ferons l’amour.
Ma suggestion ne l’intéressa pas : il voulait voir deux femmes, rien d’autre. Les cinq cents francs me passèrent donc sous le nez.
Juliette, qui m’avait écoutée sans m’interrompre, m’étonna en disant :
— Quelle gourde, cette fille ! Si un jour ça se représente, n’hésite pas : tu me téléphones.
— Ah oui ? Tu serais d’accord ? Et toi, Eric, qu’en penses-tu ?
— Tu connais mon point de vue sur le libertinage, répondit-il. Alors un billet en plus, ça ne se refuse pas.
Bernard sposorise mon opération
À cette époque, au cours de l’année 1975, j’avais obtenu les documents nécessaires — contresignés par deux psychiatres — pour subir l’opération chirurgicale consistant en l’ablation de mon sexe masculin afin de devenir une femme. C’est le Professeur M. qui devait pratiquer l’intervention à la clinique lausannoise de Montchoisi.
Quelques temps avant de me faire opérer, j’avais trouvé un appartement au rez-de-chaussée de l’avenue de Montchoisi, tout près de la clinique. Eric et Juliette m’aidèrent à déménager les rares meubles que je possédais. Il ne me manquait plus que l’argent pour enfin devenir une femme à 100 %.
Je ne savais pas comment résoudre ce problème lorsque je fis la connaissance de Bernard. J’avais un contrat de deux mois à l’Hungaria, un night-club de Montreux, et j’avais remarqué Bernard, qui venait presque tous les soirs dépenser sans compter. Il m’offrit plusieurs fois le champagne et je compris vite qu’il avait le béguin pour moi : un mètre soixante-quinze, lui qui n’en mesurait qu’un cinquante-cinq. J’appris qu’il était balayeur à la gare et que, bien que son salaire fût modeste, il avait un compte en banque bien garni, hérité de sa mère. Sachant cela, je sortis le grand jeu de la pauvre fille qui n’aimait pas son métier et qui n’avait qu’un seul désir : se marier et fonder une famille. Il me répondit que c’était aussi sa seule envie et que… nous formerions un beau couple. Le poisson était ferré, l’idylle était née, je pouvais porter l’estocade.
Je commençai par lui reprocher ses soirées à l’Hungaria, où il dépensait en moyenne deux à trois mille francs par mois :
— Autant mettre cet argent sur un carnet d’épargne à mon nom, lui proposai-je. Nous en aurons besoin pour acheter des meubles, plus tard. Et pour nous voir, je peux venir chez toi.
Ce que je fis. Je passais de temps en temps lui dire bonjour et lui soutirer un peu d’argent. Le plus difficile était de calmer ses ardeurs. Je m’inventai une virginité et lui déclarai :
— Tu dois respecter mon vœu de rester vierge jusqu’à notre nuit de noces.
Bernard fut ému et enchanté. Il se contentait donc, chaque fois que j’allais le voir, de me toucher les seins. Je lui faisais parfois une petite branlette ou, le plus souvent, je lui apportais des revues pornos en lui disant de se masturber en pensant à moi. Sa naïveté me facilitait la tâche, mais cela me créa aussi des complications.
Un après-midi, alors qu’il allait à la Poste pour payer ses factures, il rencontra le patron de l’Hungaria, qui lui dit :
— Bonjour ! On ne vous voit plus. J’espère que vous n’avez pas été malade ?
— Non. Mais je fréquente Stella, et elle ne veut plus que je vienne dépenser mes sous chez vous.
Alors qu’il me restait encore plus d’un mois à faire, mon contrat fut résilié le soir même. Je trouvai un engagement au Métropole, à Lausanne, mais j’engueulai Bernard pour m’avoir fait perdre ma place :
— C’est malin ! À cause de toi, je dois travailler à Lausanne. Je ne pourrai plus venir aussi souvent chez toi !
— Je suis désolé… répondit-il en baissant la tête. Je n’ai pas pensé à ça. Qu’est-ce qu’il faut faire ?
— Je ne vois qu’une seule solution : tu m’achètes une voiture pour que je puisse venir te trouver.
— Tu as raison. Tu en choisiras une et j’irai la payer.
Je commandai, quelques jours plus tard, une Matra-Simca Bagheera rouge. Mais j’avais oublié de lui dire que mon permis français n’était pas valable en Suisse, ce qui fait que je n’allais pas plus souvent le trouver.
La voiture nous servait surtout pour sortir : Eric la conduisait, Juliette et moi étions assises à ses côtés ; la Bagheera ayant la particularité de posséder trois sièges à l’avant.
Un jour, j’annonçai une terrible nouvelle à Bernard : je devais me faire opérer des ovaires et je n’avais pas d’assurance. Il me proposa, sans hésiter, de payer l’opération.
Un jour, quîl vint me trouver à la clinique Eric, qui était présent, lui expliqua que, malheureusement, je ne pourrais pas avoir d’enfant.
Michaël un ancien du gang des lyonnais
Après la déception de Bernard quant à son rêve de créer une cellule familiale harmonieuse avec des enfants, notre relation s’effilocha. Je poursuivais ma convalescence en compagnie de mes toujours fidèles amis, Juliette et Eric.
Je ne pouvais pas encore inaugurer mon nouveau sexe : je portais une culotte spéciale, munie d’une sorte de prothèse interne destinée à empêcher les parois du vagin de se coller entre elles. J’avais promis à Eric qu’il aurait la primeur de me posséder dès que le professeur M. me donnerait le feu vert.
Pourtant, la première fois que nous nous sommes retrouvés tous les trois nus dans le lit, Eric me couvrit de caresses et de baisers, mais ne put me pénétrer. Il inventa mille excuses pour justifier son absence d’érection, mais je savais que son blocage venait de l’image qu’il gardait de moi : j’avais été un homme.
À cette époque, j’avais fait la connaissance d’un Lyonnais prénommé Michaël. Il venait de temps à autre chez moi pour un ou deux jours ; nous faisions l’amour, puis il repartait pour son soi-disant travail. Cela me convenait. Mais, peu à peu, il commença à me demander de l’argent. J’avais repris mon travail de strip-teaseuse. Il devenait de plus en plus exigeant, puis brutal.
Un jour, Eric entra chez moi et le surprit en train de me maltraiter. Il le menaça d’appeler la police.
— Non, s’il te plaît, je dois t’expliquer mon comportement, dit Michaël.
Nous nous assîmes pour discuter. Michaël expliqua qu’il avait besoin d’argent parce qu’il était en cavale, recherché par la police française : il faisait partie du fameux gang des Lyonnais. En gage de sa bonne foi, il sortit un Walther 7,65 de sa poche le tendit à Eric et lui dit :
— Tu peux me le garder quelque temps. Je ne voudrais pas qu’on le trouve dans ma boîte à gants lors d’un contrôle de police.
Puis, se tournant vers moi :
— C’est pour ça que j’ai besoin de ton aide.
Sa douceur ne dura qu’un temps. Je décidai donc de le quitter.
Aussi, lorsqu’il revint, accompagné de deux malfrats, pour me réclamer dix mille francs sous la menace, je ne vis qu’une issue : la fuite.
J’appelai mes amis. Ils arrivèrent immédiatement. Nous prîmes le strict nécessaire. Juliette et Eric m’annoncèrent qu’ils venaient de se séparer ; Juliette avait pris un appartement à Montreux et m’y installa.
Quand Michaël appela Eric pour savoir où j’étais — il s’était rendu à mon ancien domicile —, Eric lui donna rendez-vous dans un lieu public. Il lui expliqua qu’ici, ce n’était pas Lyon, qu’il avait tout intérêt à oublier Stella. Il conserva le pistolet « par sécurité ».
En 1983, Juliette décéda d’un cancer du sein. Elle avait refusé toute intervention chirurgicale.
Je reçus ensuite mes papiers officiels attestant de mon changement de sexe : j’étais devenue Madame Dominique S.
Du strip-tease, je passai derrière le bar.
Je n’eus plus de nouvelles ni de Michaël ni d’Eric, jusqu’à un soir de 2002, dans un bar du quartier des Pâquis à Genève, où je travaillais. Un client entra ; son visage me disait quelque chose. Lorsqu’il rajusta son veston — un geste qu’Eric faisait sans cesse —, je n’eus plus de doute.
Je déposai son verre devant lui et dis doucement :
— Eric ?
Il leva les yeux vers moi et, avant qu’il ne prononce mon ancien prénom, je précisai :
— Maintenant, je suis Dominique. Ici, personne ne connaît mon passé. Je vais même chez le gynécologue, comme toutes les femmes.
Eric me raconta qu’il avait eu un enfant, qu’il était divorcé et qu’une dizaine d’années auparavant, Michaël l’avait retrouvé pour lui réclamer son pistolet. Celui-ci avait disparu lors du divorce ; son ex-femme s’en était débarrassé.
Après avoir bu son verre, Eric quitta le bar et... ma vie.
Note de l’auteur :
Cette histoire est authentique. Certains noms ont été changés et quelques passages romancés pour la fluidité du récit.
La dernière fois que j’ai vu Stella — Dominique —, c’était dans ce bar de Genève, en 2002. Je ne sais pas aujourd’hui si elle est toujours en vie.
Je vis désormais en Thaïlande, pays où l’on croise quotidiennement des transsexuels, mais il faut se rappeler qu’en 1976, en Suisse, lorsque j’ai connu Jean-Claude S., c’était extrêmement rare. Je suis heureux d’avoir été à ses côtés durant une grande partie de sa vie, surtout au moment où la chrysalide est devenue papillon.